02/09/2012
Jack London
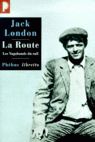 Jack London, La route... Les vagabonds du rail (Coll. Libretto/Phébus, 2001)
Jack London, La route... Les vagabonds du rail (Coll. Libretto/Phébus, 2001)
La route en question, c'est le libre et dur chemin du hobo, ce vagabond sans feu ni lieu qui voyage sur l'essieu des wagons, dort au creux des fossés, mange ce qu'il chaparde, ou ce que lui offrent les bonnes âmes, et ne connaît bien souvent d'autre toit que celui de la prison. Pendant l'année 1893-94, l'auteur - il a alors 18 ans - parcourt de la sorte quelque 20 000 km à travers les États-Unis, à la barbe de la police. Malgré la faim, les dangers, les humiliations. Il en tire un récit à la Chaplin : soulevé de bout en bout par un formidable appétit de vivre, un humour et un culot également désarmants. L'un des plus beaux hymnes jamais dédiés à la jeunesse et à la liberté. Farouche pourfendeur de la monotonie, Jack London se mêle au fil de ces récits aux miséreux, clochards, mendiants et vagabonds qui sillonnent les Etats-Unis. Leçon de vie d’un voyageur sans billet, ces célébrations du moment présent demeurent très actuelles.
publié dans le supplément La bibliothèque idéale des vaudois / 24 Heures
06:26 Écrit par Claude Amstutz dans La bibliothèque idéale des vaudois, Littérature étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2012
Jean-Denis Bredin
 Jean-Denis Bredin, Trop bien élevé (Coll. Livre de poche, 2009)
Jean-Denis Bredin, Trop bien élevé (Coll. Livre de poche, 2009)
A travers le regard d’un enfant de dix ans, Jean-Denis Bredin raconte sa propre histoire entre 1939 et 1945 : la mort prématurée de son père, ses camarades dont il cherche les traces, sa mère aimante et aimée, dont les sentiments n’ont jamais véritablement franchi les lèvres… Comme devant une carte postale jaunie par le temps, vous resterez proche de ces instantanés empreints de sensibilité, de courage, hors de toute dérive mélodramatique. Attachant !
02:33 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2012
Sophie Fontanel
 Sophie Fontanel, Grandir (coll. Livre de poche/LGF, 2012)
Sophie Fontanel, Grandir (coll. Livre de poche/LGF, 2012)
La narratrice de ce récit a beaucoup de chance. auprès d'une mère comme la sienne - avec son sourire qui donne accès à la splendeur du monde - et elle le lui rend bien, à ce moment crucial de l'existence que nous redoutons tous, pour autant que nous aimions nos parents: La vieillesse, les accidents, la maladie, la dépendance réciproque, la proximité de la perte, le deuil.
A la première chute de sa maman, elle est désemparée. Le ciel lui tombe sur la tête: Une mère à terre, je pensais qu'il suffisait de la soulever (à deux, avec la gardienne de l'immeuble), de la remettre dans son lit pour que ça se tasse. Que le rétablissement se goupille de lui-même. Eh bien, j'ai appris. Dans son lit, avec deux fractures et des ligaments déchirés, ma mère se laissait mourir. Elle refusait que j'appelle une ambulance. Refusait le médecin. Refusait les soins. Refusait la nourriture. Refusait l'eau comme s'il se fût agi d'un breuvage où l'on aurait glissé des gouttes susceptibles de tuer sa résistance. Une porte blindée, ma mère. Refusait bien sûr de sourire, et quelle naïveté aussi j'avais de le lui demander dans une pareille détresse.
Pourtant, elle tient bon. Par amour pour sa mère de quatre-vingt six ans, indépendante, qui n'aime pas déranger, elle accepte de s'occuper d'elle au quotidien, subissant de plein fouet ses chutes répétitives, ses pertes de mémoire aussi. Elle connaît les couloirs des hôpitaux, les infirmières et les aides ménagères - dont elle parle avec une bienveillance naturelle - puis les maisons de repos, les soins. L'équilibre de sa propre vie s'en trouve mis à rude épreuve. Un jour, une de ses amies donne un sens à sa douleur et à son impuissance, en lui confiant: Ta maman est tombée encore une fois? Pauvre, pauvre, maman, je sais ce que tu ressens. Oh je sais que la vieille personne c'est toi-même. C'est à toi dans ces moments-là chaque minuscule vertèbre qui sort du dos de la personne âgée, des épines d'hippocampe, et ça lui fait si mal si on oublie de lui mettre les coussins. C'est à toi cette défaite, c'est ta pesanteur, et c'est toi aussi qui pèses ce poids de la vieille personne, et je sais que même la plus légère est insupportable, c'est à toi cette fin de vie...
Si le sujet du livre de Sophie Fontanel - probablement une autofiction - est grave, il est cependant parcouru par un formidable élan d'amour et de gratitude qui, la plupart du temps, transfigure jusqu'aux instants les plus pénibles. S'y ajoute une écriture pleine de fraîcheur qui vole de page en page comme une canne invisible auprès de cette mère qui ne veut pas disparaître: Sa meilleure amie sur terre. Elle saisit avec beaucoup de tendresse et d'humour les petits riens de ce quotidien à l'étroit qui font toute la différence: Sa gourmandise, ses coquetteries, ses espiègleries, ses rêves, ses désirs de croquer la vie à pleines dents, aujourd'hui, auprès de sa fille chérie.
Cette dernière grandira. Elle apprendra qu'être solidaire, c'est anticiper; que ce temps qui s'inverse, où la mémoire s'en va, paradoxalement s'accompagne d'une lucidité accrue; qu'une mère à de droit de céder au découragement; que l'amour partagé distille la force, le courage, le rire. Reste l'interrogation, à l'adresse de nous qui pour un temps encore foulons avec allégresse la terre sous nos pieds: Je pense qu'un jour moi aussi, je serai âgée, moi aussi je passerai un cap et je devrai m'en remettre à la bienveillance d'autrui. Lorsque ce jour viendra, qui dans ce monde pourra faire pour moi ce que je fais pour ma mère? Qui sera présent? Qui me soutiendra quand, à mon tour, je serai une personne vulnérable? Et est-ce que je me tuerai un jour, pour cause de ce manque d'amour très particulier qui est le manque d'aide?
L'amour vrai est éternel, selon Balzac, infini et toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstrations violentes: On le voit avec les poils blancs et est toujours jeune au coeur.
Une première clef qui ouvre bien des tiroirs secrets...
07:26 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2012
Patrick Modiano
 Patrick Modiano, Un pedigree (Coll. Folio/Gallimard, 2006)
Patrick Modiano, Un pedigree (Coll. Folio/Gallimard, 2006)
J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma vingt et unième année, je les ai vécus en transparence - ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages, alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi : tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie.
Patrick Modiano parle de son père et lève avec pudeur et humour parfois le voile sur lui-même, sans fard. Sensible et sobre, à l’image de son auteur.
08:16 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2012
Emmanuelle Pagano
 Emmanuelle Pagano, L'absence d'oiseaux d'eau (coll. Folio/Gallimard, 2012)
Emmanuelle Pagano, L'absence d'oiseaux d'eau (coll. Folio/Gallimard, 2012)
Ce roman était à l'origine un échange de lettres avec un autre écrivain. Nous nous l'étions représenté comme une oeuvre de fiction que nous construisions chaque jour, à deux, et dans laquelle nous inventions que nous nous aimions. Nous ne savions pas jusqu'où le pouvoir du roman nous amènerait. Nous ne connaissions pas la fin de l'histoire. Il est sorti de ma vie brutalement, abandonnant ce texte en cours d'écriture, annonce l'auteur en préambule à son dernier livre.
Chronique amoureuse épistolaire, à une seule voix, où le jeu en écriture vire à l'attirance, au besoin de fusion avec l'autre, à la sublimation, au choc du réel puis à la rupture, ce récit raconte une passion fulgurante qui s'empare d'une femme rangée en apparence, mariée, mère de quatre enfants, prête à tout quitter pour la vivre. Amoureuse des mots, elle décrit avec un rare bonheur les arcanes du désir, la crucifixion de l'absence, les risques que sous-entend cette relation charnelle absolue, sans illusions, ni fards, ni concessions. D'un lyrisme et d'une impudeur qui ne prêtent jamais à la vulgarité ou au voyeurisme, Emmanuelle Pagano use au contraire d'un langage poétique ensorcelant pour dire la brûlure qui l'étreint: La rivière est si profonde quand tu me pénètres que je la confonds avec toi. Je voudrais que tu redeviennes ma rivière chaque jour. Je voudrais que tu glisses, que tu coules, je voudrais te boire, me baigner en toi, encore, elle est si profonde, l'eau, que tu me portes, c'est toi qui es en moi mais tu me portes, je flotte, puis je replonge, et tant pis si le courant t'éloigne, après.
Si le lit de l'amour - ou son point de convergence - est un livre, si le point culminant de cette histoire s'exprime dans un érotisme torride, sans tabou, l'homme pourtant partira, laissant derrière lui une femme meurtrie que hante le souvenir, qu'immortalise le texte. Roman autobiographie, oeuvre de fiction, ou un peu des deux? L'auteur lève un coin du voile à la fin de son récit: Je crois avoir écrit un livre avec un homme qui n'existe pas, je crois avoir rêvé ses réponses pour continuer mes lettres, je crois avoir rêvé ses gestes, son ventre, ses bras. Est-ce que cet homme était toi?
Peu importe la conclusion. La voix d'Emmanuelle Pagano glisse sur le papier pour y éclairer un paysage qui ne ressemble à rien et dans le tremblement des corps laisse une empreinte incandescente. Qui s'en plaindrait?
08:54 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2012
Nina Bouraoui

Nina Bouraoui, Appelez-moi par mon prénom (Stock, 2009)
00:08 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2012
Morceaux choisis - Jean-Louis Kuffer
Jean-Louis Kuffer

Il n'y a pas de temps mort: voilà ce que me dit cette croix clouée en moi. Voici le jour se lever sur le monde des gens ordinaires, et nous allons tenter de vivre de nouveaux ou de nouvelles après-midi. Le passé nous attend dans la forêt de la ville où nous allons retourner tout à l'heure pour gagner notre vie en dignes gens ordinaires, et l'éternelle matinée sera aux affaires et ce seront ensuite de belles ou de beaux après-midi, ce sera selon, en attendant le retour des enfants...
Je vis, une fois de plus, à l'instant, l'émouvante beauté du lever du jour. L'émouvante beauté d'une aube d'automne aux verts passés et aux bleus tendres. L'émouvante beauté de l'or du temps qui ne rapporte rien. L'émouvante beauté des gens le matin. L'émouvante beauté d'une pensée douce flottant comme un nuage immobile sur le lac d'étain, tandis que le ciel vire au rose. L'émouvante beauté de ce que ne voit pas l'aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret.
Je me dis souvent qu'il n'y a rien de beau ni d'émouvant dans la vie de trop de gens piétinés, mais qu'en sais-je? Que savons-nous des gens me dis-je à l'instant en traversant le selva oscura de la ville aux affaires? Qu'aurais-je jamais su de Grossvater et qu'aurons-nous su de nos pères et de nos mères? Tout à l'heure ils vont se retrouver à leurs guichets de gens ordinaires. L'émouvante beauté de ces gens. Regarde ta mère traverser la rue du Temps. Regarde ton père la regarder, ce soir-là dans un bar. Regardez, les enfants: regardez voir...
Jean-Louis Kuffer, L'enfant prodigue (D'Autre Part, 2011)
image: Lucienne Kuffer, Peinture (2009)
00:35 Écrit par Claude Amstutz dans Jean-Louis Kuffer, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2012
Morceaux choisis - Mario Rigoni Stern
Mario Rigoni Stern

Quand le beau temps coïncide avec ma disponibilité, j'aime partir avec mes souvenirs sur les sentiers et les chemins forestiers; j'observe, aussi, et j'écoute, les signaux que la nature communique au fil des saisons et des années. Mais c'est quand des amis se joignent à moi que je rêve et réfléchis le plus. Ces compagnons de route ne sont plus présents physiquement, leur corps est resté dans des endroits lointains: enseveli sur des montagnes, ou dans la steppe; dans des cimetières de village avec une simple croix, ou de ville avec une dalle et des fleurs. Et c'est avec eux que je suis et que je converse, en me souvenant. Ceux qui ne croient pas, ou ceux qui croient, peuvent regarder ma façon d'agir avec une bienveillante indulgence. Peu m'importe: moi aussi j'ai des doutes mais il me plaît, certaines fois, de les ignorer.
Dans "De senectute", Bobbio écrit: "Quand tu parcours les lieux de ta mémoire, les morts se pressent autour de toi, et leur groupe devient chaque année plus nombreux. La plus grande partie de ceux quio t'ont accompagné t'ont abandonné. Mais toi tu ne peux pas les effacer comme s'ils n'avaient pas existé. Au moment où tu les rappelles à ton esprit tu les fais revivre, au moins pour un instant, et ils ne sont pas tout à fait morts, ils n'ont pas complétement disparu dans le néant..." Dans ces lumineuses journées de fin d'hiver je pars presque chaque matin par une route en plein bois avec mes skis légers aux pieds; et aujourd'hui c'est le cher Primo Levi qui m'accompagne. Jadis il m'avait écrit qu'il aurait voulu tout abandonner, prendre ses skis et venir avec moi; mais il lui était difficile de sortir de la ville: les embouteillages, le trafic sur l'autoroute, les obligations qu'il avait, et bien d'autres choses encore, ne lui permettaient pas de le faire. Maintenant, dégagé de ces liens. il peut le faire et il m'attend au carrefour où la route forestière, que le chasse-neige ne déblaye pas, se détache de la nationale et s'enfonce entre les arbres encore décorés par la dernière chute de neige.
Mario Rigoni Stern, Sentiers sous la neige (La Fosse aux Ours, 2000)
mage: Alfred Sisley - La neige à Louveciennes
01:32 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature italienne, Mario Rigoni Stern, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2012
Morceaux choisis - Colette Fellous/Paul Nizon
Colette Fellous et Paul Nizon

Je dévorais et buvais sa présence, ses yeux avec ces mignones petites taches dans le brun clair, la bouche joliment peinte, et surtout cette façon qu'avaient ses lèvres de laisser passer la voix. Pas seulement le son, mais les mots, les phrases dans cette langue étrangère que j'aime tant, et quel frisson quand cette voix prononçait mon nom. Je ne pouvais me rassasier de son visage ni de ses doigts fins aux ongles merveilleusement soignés qui maniaient les couverts.
J'enregistrais tout cela, ce port de reine, la lumière de son visage, notre intimité, et j'étais conscient que cette heure et ces secondes n'auraient eu lieu qu'une fois, j'aimais t sentais le monde autour de moi comme jamais, la rue avec ses mélopées du soir, tout, j'étais aveugle et voyant. Miracle sur miracle, moi avec elle, dans cette ville unique, et c'était comme si elle l'avait inventée pour moi et qu'elle me l'offrait, à moi. A moi seul.
Colette Fellous et Paul Nizon, Maria Maria (Maren Sell, 2004)
08:29 Écrit par Claude Amstutz dans Colette Fellous, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2011
Quentin Mouron
Bloc-Notes, 15 novembre / Les Saules

C'est dans l'air, ces phrases anodines, pour insinuer que tout a été dit, que tout a été écrit et qu'à ce bon compte, autant relire les textes fondateurs, les vieux classiques, les immortels, bref, ceux qui font l'unanimité ou presque. Pas d'embrouilles avec les amis de plume, les appréciations de style ou l'ordre des choses. Seulement voilà, je me sens un peu comme Georges Perros: dans L'occupation et autres textes, il note: Vous me conseillez quelquefois, pour me calmer, la lecture des Anciens. Oui, bien sûr. Mais je suis avec les vivants. Bon gré, mal gré. Plus loin, il ajoute: Bien écrire, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui on ne peut souhaiter que la rupture totale. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas le faire exprès, mais le vivre. Ce que j'aime chez un écrivain, c'est ce qui lui échappe.
Ce lien entre un auteur devenu ancien et un moderne, me saute aux yeux après avoir achevé la lecture de Au point d'effusion des égouts, premier roman formidable d'un jeune écrivain canado-suisse de 22 ans, Quentin Mouron, qui doit son titre à une phrase d'Antonin Artaud. Il nous entraîne dans un road movie à travers les States qui, dans la tête de ce découvreur à couteaux tirés avec la réalité, absorbe le quotidien, l'imaginaire des autres, les paysages à grande vitesse - on pense à Nord, d'un certain Louis-Ferdinand Céline - et cela avec une virtuosité de vieux baroudeur: J'avais fait en partant le pari fou de m'envoler. Depuis tout en bas du soleil. Me chauffer au point le plus élevé de la solitude, plus haut que le brouillard des foules - qu'une vie entière ne suffise pas à redescendre.
De Los Angeles à Las Vegas, en passant par Trona, la Death Valley et Beatty, il nous brosse un portrait souvent pathétique, terrifiant et sans fard de ses lieux de passage, dont Los Angeles, où tout a commencé: C'est la Cité des anges, c'est entendu. Mais des anges poussiéreux, noirs à l'os - et qui tombent à grosse grêle sur le dur des trottoirs. (...) C'est une poupée russe qui termine sur le vide. Un précipice vertigineux qu'on est forcé d'affronter quand on a pris la ville à bras et qu'on a fait jaillir tous ses spectacles les uns des autres - et qu'il ne nous reste dans la paume que le souvenir de l'illusion.
Quentin Mouron n'est pas plus tendre avec Pasadena - un petit satellite universitaire qui suit en moutonnant les révolutions qui lui échappent - ou Las Vegas: Des centaines d'hystéries qui se tissaient sous chaque enseigne, des pâmoisons. Je les voyais. Le long des rues. Titubant. (...) Les casinos sont des chapelles énormes, des variations de culte en l'honneur d'un même Dieu dans les pince-fesses saturés d'encens et de vapeurs de con. Les croyants ont toujours à vêpres une foi d'enfer et un moral de plomb. Il n'y a que le matin qu'ils pleurent un peu, quand ils ont des confettis dans les cheveux, et des petits miracles séchés au coin des yeux.
Dans ces décors un peu felliniens - entre Il Bidone et I Vitelloni - l'un des points culminants du roman se situe à Trona, un bled au milieu de nulle part - où à seize ans vous êtes trop vieux pour qu'on s'occupe de vous - concentré d'horreur, de désespoir et de féroce humour: L'église de Trona, c'est un bunker. Un cube de tôle. Une croix dessus. Aucun vitrail, aucune fenêtre! Qu'une très grande porte rouillée qui hurle sur ses gonds. Aucun parvis. De la poussière. Le milieu du désert. Au bord d'un lac séché depuis deux siècles. Le sable qui grimpe en haut des murs... Et des grillages autour... L'intimité des fidèles... Avec des barbelés! C'est pas à rire... Je n'y ai vu personne. Aucune messe. Aucun psaume. Un container rouillé - sans fenêtres, sans fidèles - sans bon Dieu. J'ai essayé d'imaginer le prêtre... S'il y croyait encore? Ce qu'il pouvait leur dire? L'audience? Quelques vieillards qui viennent prendre un ticket... Au cas où. (...) J'ai entendu dire qu'il avait volé la banderole d'un supermarché pour la coller sur la façade de l'église: ouvert le dimanche! Les fidèles sont revenus voir... On a déposé plainte. Il avait depuis tenté toutes sortes de ruses... Bénir les billets de loterie, les pick-up, les boîtes de conserve, la benzine! Un voisin l'a vu imposer les mains sur le jerricane d'un motard stoppé là par hasard.
L'accent se fait plus tendre, candide et lucide à la fois quand il évoque ses rencontres de passage dont Laura, touchant fil conducteur de ce périple défricheur qui ressemble à une éducations sentimentale et le fait trébucher d'amour: Elle avait l'air d'un prisonnier qui tend le cou pour de l'air frais, et que la mer, même par temps gris, fascine et attire.
Parti peut-être aux Etats-Unis pour ne jamais en revenir, comme beaucoup d'autres, il reviendra de son rêve américain au pays, meurtri, égaré, grandi, décrivant judicieusement le contraste entre la folie au loin et la sagesse ici; le parfum de liberté, de tolérance à l'originalité là-bas et le conformisme ambiant de sa patrie, dont il ne veut plus: J'ai perdu. Je suis rentré. D'un voyage c'est le retour qui vous claque à la gueule. Quand après avoir léché les grands ciels du bout du monde, vous tombez de l'avion - boum - au giron des familles. Vous vous apercevez que les visages n'ont pas changé, les mêmes rides, les rictus, le papier-peint de la cuisine... Les mêmes mots, les mêmes meubles, la moquette, les mêmes blagues. Le chat. Les odeurs. La cage jaune du canari. Les maladies. Et le carrelage fendu, les fissures, les mêmes bruits... Vous n'êtes plus certain de quand vous êtes parti, ni d'être vraiment parti. (...) Eux ne remarquent pas que leur réel n'a aucun sens pour nous. Précisément parce que ce qu'ils appellent réalité, n'en est qu'un répugnant flambeau, et que leur vie se situe dans un contournement de la vie même. (...) J'atteste que je n'irai pas embellir leurs égouts.
Avec ses musiques du bout du monde qui le font frissonner, Quentin Mouron, écorché vif bourré de talent et de sensibilité, me ramène à Georges Perros qui s'interrogeait sur le sens de la lecture et de l'écriture: Aimer la littérature, c'est être persuadé qu'il y a toujours une phrase écrite qui nous re-donnera le goût de vivre, si souvent en défaut à écouter les hommes. Soi-même, entre autres.
Qu'il s'en souvienne, Quentin Mouron! Il faut vraiment lire Au point d'effusion des égouts: vous n'en sortirez pas indemne ou blanchi, mais gonflé comme la voile d'un trois-mâts qui nous aspire vers un ailleurs possible et assouplit nos artères saturées de cholestérol...
Quentin Mouron, Au point d'effusion des égouts (Olivier Morattel, 2011)
Georges Perros, L'occupation et autres textes (Joseph K, 1996)
images: Quentin Mouron et Georges Perros

09:35 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Georges Perros, Littérature francophone, Littérature suisse, Louis-Ferdinand Céline | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












